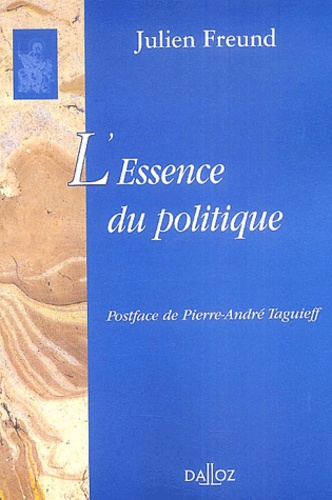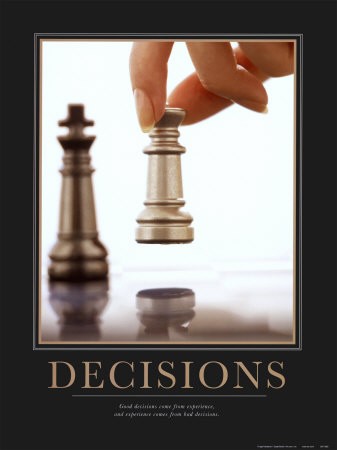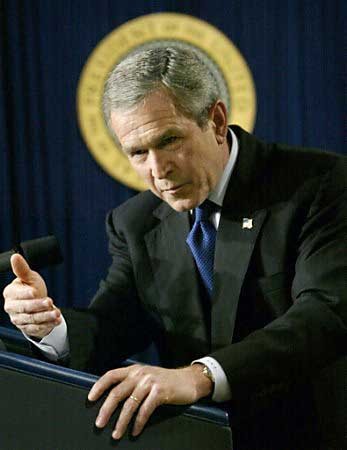LA EMPRESA PARA QUIEN LA TRABAJA
por Javier Iglesias
El texto que sigue ha sido reeditado en Barcelona (1998) por la Asociación Alternativa Europea. Su autor, de origen español, era dirigente del peronismo, lider del Movimiento de los Sin Techo bonaerense cuando, en septiembre de 1996, fue asesinado en la capital argentina en una emboscada tendida por la policía menemista.
Introducción
Las realizaciones y conquistas sociales del Peronismo en su primera etapa de gobierno (1946-1955), son tantas y tan importantes que, entre los propios seguidores de dicho Movimiento, es común interpretarlas como el fruto de una Revolución totalmente realizada; una especie de "Edad de Oro" de los trabajadores y del Pueblo argentino que, con algunas variaciones de detalle, puede y debe recuperarse mediante la organización y la lucha.
Paradójicamente esa versión del Peronismo como una Revolución "concluida" que hay que repetir y recuperar, no coincide en lo más mínimo con lo que pensaban aquellos que la llevaron a cabo en el pasado, ni mucho menos y en especial, con los planteamientos del mismo General Juan Domingo Perón. Para todos ellos, la riquísima experiencia política, económica y social del periodo 1943-1955 es apenas el inicio de una transformación revolucionaria mucho más profunda y, por lo que se refiere a lo económico, el verdadero comienzo de un proceso de gradual socialización de los medios de producción.
Que ese objetivo socializante es afirmado explícitamente y desde un principio por importantes sectores del Movimiento Peronista, puede probarse con la simple lectura de los estatutos de la CGT aprobados en su Congreso Extraordinario de abril de 1950. En su Preámbulo, después de afirmar que "la Doctrina Peronista, magistralmente expuesta por su creador, el General Juan Perón, define y sintetiza las aspiraciones fundamentales de los trabajadores argentinos y les señala la verdadera doctrina, con raíz y sentido nacional, cuya amplia y leal aplicación ha de forjar una Patria Justa, Libre y Soberana", fundamentan esa definición ideológica en el hecho de que:
"El proceso de realización tiende hacia la gradual socialización de los medios de producción y en cambio impone al proletariado el deber de participar y gravitar desde el terreno sindical para afianzar las conquistas de la Revolución Peronista, para consolidarlas en el presente y ensancharlas en el futuro". [1]
La inequívoca definición del Movimiento Obrero Argentino -calificado habitualmente por el General Perón como la "columna vertebral" del Peronismo- no es, por otra parte, una simple declaración sectorial. En ocasión tan importante como el 1º de mayo de 1952, en su alocución a los legisladores argentinos con motivo de la inauguración del 86º periodo ordinario de sesiones del Congreso Nacional, el propio Líder justicialista también afirma tajantemente:
"Así como la clase de los hombres que trabajan va substituyendo a los representantes del individualismo capitalista en el panorama político, también la clase de los hombres que trabajan va substituyendo progresivamente a las empresas individualistas, con las nuevas organizaciones de tipo cooperativo. Ello significa que los trabajadores, por la natural evolución económica de nuestro sistema, van adquiriendo progresivamente la propiedad directa de los bienes capitales de la producción, del comercio y de la industria. Este camino, por el que avanzan ya los trabajadores argentinos, tiene un largo pero fecundo recorrido y posibilitará el acceso del pueblo a la conducción de su propia economía. El viejo ideal del pueblo, en la plena posesión de sus derechos políticos, sociales y económicos, se realizará entonces, y en aquel momento la justicia social alcanzará la cumbre de sus objetivos totales y la doctrina peronista será la más bella y absoluta de las realidades". [2]
Que el Peronismo fundacional aspiraba a la total socialización de "los bienes capitales de la producción, del comercio y de la industria" resulta, pues, irrefutable, más allá del ritmo de esa socialización; ritmo que, como es natural, depende más de la cambiante relación de fuerzas nacional e internacional que de cuestiones ideológicas o esquemas teoricistas de salón.
Tercera Posición
Cuando, a partir de los propios textos peronistas, afirmamos que el Peronismo apunta hacia la socialización de los medios de producción, ¿estamos coincidiendo con la acusación del "nacionalismo" fascistizante y antiperonista según la cual el Justicialismo sería "un movimiento que sale del capitalismo y camina hacia el comunismo"? [3] Obviamente no. Los creadores de la Doctrina Peronista siempre recalcaron su carácter de "Tercera Posición"; sus postulados anticapitalistas pero, a la vez, diferentes de los del colectivismo totalitario y burocrático marxista. En el ya citado discurso del 1º de mayo de 1952 es también Perón el que recalca magistralmente ese "tercerismo" económico peronista:
"Para el capitalismo la renta nacional es producto del capital y pertenece ineludiblemente a los capitalistas. El colectivismo cree que la renta nacional es producto del trabajo común y pertenece al Estado, porque el Estado es propietario total y absoluto del capital y del trabajo. La doctrina peronista sostiene que la renta del país es producto del trabajo y pertenece por lo tanto a los trabajadores que la producen." [4]
El Peronismo no confunde, por lo tanto, socialización con estatización. Es anticapitalista pero pretende, a diferencia del marxismo, no la entrega de los medios de producción a un gigantesco Estado-Patrón dictatorial sino directamente a los propios trabajadores. Se trata de una concepción con mucha semejanza con lo que posteriormente será conocido como "socialismo autogestionario" [5] aunque también puede considerarse emparentada a las posiciones del anarcosindicalismo y del "sindicalismo revolucionario" europeo anterior a la Segunda Guerra Mundial; algo que han destacado recientes estudios ideológicos imparciales como los de Cristián Buchruker: "Más que del socialismo clásico, el peronismo en gestación adoptó ideas fundamentales del anarcosindicalismo hispano-francés, el cual ya tenía una tradición no despreciable en el gremialismo argentino. Se trata aquí de dos exigencias: a) el directo protagonismo político del sindicato (no por mediación del partido) sobre todo a través de la huelga general como instrumento de acción; y b) el objetivo lejano de una administración de los medios de producción por los sindicatos mismos." [6].
Postmarxismo revolucionario
Debe destacarse, por otra parte, que el "tercerismo" peronista no implica necesariamente "equidistancia" con respecto al capitalismo y al comunismo. En ello es igualmente diáfano Perón:
"Pensamos que tanto el capitalismo como el comunismo son sistemas ya superados por el tiempo. Consideramos al capitalismo como la explotación del hombre por el capital y al comunismo como la explotación del individuo por el Estado. Ambos 'insectifican' a la persona mediante sistemas distintos. Creemos más; pensamos que los abusos del capitalismo son la causa y el comunismo el efecto. Sin capitalismo el comunismo no tendría razón de ser, creemos igualmente que, desaparecida la causa, se entraría en el comienzo de la desaparición del efecto." [7]
Es decir: el objetivo del Peronismo no es otro que hacer desaparecer el capitalismo -la "causa" de todos los problemas económicos, políticos y sociales- lo que, por si mismo, impedirá que surja un "efecto" indeseado: el capitalismo estatal "insectificante" comunista. Esta distinción es enormemente importante porque hoy, ante el pase de las burocracias ex-comunistas de la URSS y Europa del Este al bando capitalista encabezado por los archibandidos yanquis, no faltan pícaros supuestamente "peronistas" que declaran "superada" la Tercera Posición y "recomiendan" la "aceptación del triunfo capitalista". A esos proveedores de coartada de la claudicación y el más infame renunciamiento, les conviene repasar las luminosas enseñanzas de Perón y la compañera Evita: "El peronismo no puede confundirse con el capitalismo, con el que no tiene ningún punto de contacto. Eso es lo que vió Perón, desde el primer momento. Toda su lucha se puede reducir a esto: en el campo social, lucha contra la explotación capitalista." [8].
El Peronismo, por lo tanto, se enfrenta implacablemente al capitalismo más allá de si el comunismo existe o no. Su rivalidad con el marxismo es en el terreno de la eficacia revolucionaria: ver quién consigue derribar finalmente al injusto sistema capitalista. De ahí las precisas orientaciones del General Perón: "Nosotros somos la cabeza del movimiento nacional revolucionario. A ningún partido o movimiento se le debe permitir colocarse en una actitud más 'revolucionaria' que la nuestra. El día que eso ocurriera, habríamos perdido nuestra 'razón de ser' como movimiento, al ser reemplazados en la conducción popular. A los justicialistas que se coloquen en actitudes 'conformistas' o 'conciliadoras' para con el sistema imperante en nuestra patria, hay que expulsarlos del Movimiento sin miramientos. Son enemigos del pueblo y por lo tanto, enemigos nuestros." [9].
La deserción de las cúpulas marxistas -ya sean socialdemócratas o comunistas- del frente revolucionario al que supuestamente pertenecían, resuelve en la práctica el pleito entre Peronismo y marxismo al probar que el único anticapitalismo y antiimperialismo posible en la actualidad es el corporizado en Movimientos Nacional-Populares y Terceristas de Liberación: auténtico Peronismo argentino, bolivarianos de Venezuela, fundamentalismo revolucionario islámico de las naciones y pueblos musulmanes, resistencia armada torrijista panameña, etc. Los escasos núcleos que, con mejores deseos que resultados, aún intentan seguir aferrados a la vieja liturgia tradicional comunista, antes o después abandonarán las marchitas y superadas banderas del comunismo para integrarse lisa y llanamente a las pujantes fuerzas del nacionalismo popular revolucionario y de la Tercera Posición.
Proceso de socialización
Siendo el General Perón el conductor de un proceso revolucionario real y no un utopista de gabinete, es lógico que el grueso de su producción teórica más que dedicarse a teorizar sobre la sociedad futura se concentre en los problemas prácticos de un gobierno de liberación nacional y social o, tras la contrarrevolución oligárquica de 1955, en la lucha concreta para la recuperación del poder por parte del pueblo argentino. Eso no significa que el proceso de socialización por el propugnado sea tan a largo plazo que se convierta en una simple e inoperante expresión de deseos o fórmula retórica. De hecho el máximo dirigente justicialista expone en forma constante y repetida las fórmulas específicas que, a su juicio, revestirá ese proceso de socialización no estatista. Un interesante aporte doctrinario en ese sentido es el vertido en una larga conferencia concedida en 1970 al periodista uruguayo Carlos María Gutiérrez, corresponsal de Prensa Latina. Ante la pregunta "¿usted cree que además habría de ir, en el caso de la toma del poder, a la destrucción de ese tipo de estructuras burguesas; digamos, de la libre empresa, para emplear el término corriente? ¿Ir más allá de lo que se fue entre 1950 y 1955?", Perón responde sin la menor duda: "Nosotros lo estábamos haciendo, pero lo estábamos haciendo a través de un sistema. Que ya había empresas... Las cervecerías del país estaban todas en manos de una cooperativa del sindicato de cerveceros. Yo pensaba hacer lo mismo con los ferrocarriles, en cuanto suprimiera el déficit; entregarlos al sindicato de los ferrocarriles. Y había fábricas, como... De la Lanera del Sur... la... no me acuerdo cómo se llama, que ya estaban sobre ese sistema.
La concepción es ésta: un promotor de empresa emplea cien millones para promover una empresa. Hasta que él ha retirado esos cien millones más su interés, esa empresa debe ser exclusivamente de él. Pero cuando ha retirado su capital, más un interés razonable, esa empresa ya no es de él; es de todos los que la trabajan. Esa es la concepción cooperativista de la empresa. Por ese sistema, usted va llevando todo hacia cooperativas; cooperativas donde trabajan patrones, obreros y todos, pero que trabajan en la producción.
Ahora, si eso no se hace en todas las empresas, el Estado, al final tendrá que hacerse cargo de aquellas donde no se ha realizado." [10].
Se trata de una cita tan extensa como instructiva que nos muestra un modo (no el único propuesto por Perón) de llegar gradual e incruentamente a la entrega de los bienes de producción a los trabajadores; recalca la concepción cooperativista-sindical de ese proceso de socialización y, a la vez, recuerda ejemplos concretos con los que el Peronismo en el poder avanzó en ese sentido.
Cooperativas y Peronismo
La concepción de las formas cooperativistas de propiedad como uno de los medios principales de socialización no estatista de la economía es lógica "porque -como recalca Perón- es un ideal justicialista que todo el proceso económico quede en manos de los 'hombres que trabajan' y el sistema cooperativo tiende a ello." [11].
Que no se trata de una mera declaración retórica salta a la vista si comparamos, por ejemplo, las cifras relativas al cooperativismo argentino entre 1946 y 1951. Entre esas fechas, el número de cooperativas pasa de 1.299 a 2.400, el número de asociados de 500.000 a 800.000, el capital suscrito (en millones de m$n) de 95 a 350, y las operaciones efectuadas (también en m$n) de 361 a 2.000. O dicho sea de otro modo: en apenas cinco años el sector cooperativo aumenta en un 100% en su número, en un 60% en asociados, en un 260% del capital suscrito, y en un 440 por ciento de las operaciones realizadas.
Este gigantesco salto se profundiza aún más a partir de 1952 y, sobre todo, con la promulgación del Segundo Plan Quinquenal. En su exposición del 1º de mayo de ese año, el General Perón muestra esa línea estratégica en lo económico: "Las cooperativas agrarias han merecido nuestro total apoyo, como que ellas son, en la economía social de la doctrina peronista, unidades de acción económica que realizan el acceso de los hombre que trabajan a la posesión total del instrumento y del fruto de sus esfuerzos. La ayuda crediticia a las cooperativas alcanzó en el quinquenio a la suma de 1.000 millones de pesos y va en progresivo aumento. Señalo como norma tendida hacia el futuro la de preferir en el crédito a las organizaciones cooperativas sobre las empresas de carácter individual. Llegaremos progresivamente a dejar en manos de la organización cooperativa agraria todo el proceso económico de la producción. No debe haber en el país un sólo agricultor que no sea cooperativista, porque la organización cooperativa es al trabajador agrario lo que la organización sindical es al trabajador industrial, sin que esto signifique que la industria no pueda organizarse en forma cooperativa." [12].
La cooperativización-socialización total de los medios de producción es, por lo tanto, un objetivo explícito del Peronismo. Esa cooperativización se concentra en un principio sobre todo en el terreno agrario, por ser ésta un área económica de más fácil socialización y donde, además, existe una notable tradición de organizaciones cooperativas previa al Justicialismo, pero se expande hasta lograr el fin señalado por Juan Domingo Perón: las "cooperativas como unidades básicas justicialistas para la organización nacional de la producción, la industria y el comercio." [13].
Estado Revolucionario
La defensa que el Peronismo hace del modelo cooperativo de organización económica, no puede ni debe confundirse con las fantasías reformistas que sobre las cooperativas tienen grupos pequeñoburgueses como los diversos desprendimientos del Partido Socialista del reputado gorila Juan B. Busto. El Movimiento Nacional de Liberación creado por Perón, al contrario que dichos grupos socialdemócratas, sabe que, aunque parezca una perogrullada recordarlo, el sistema capitalista está creado para que triunfen los capitalistas y, por tanto: "Los fracasos del cooperativismo, en tiempos de la economía capitalista, son explicables y perfectamente lógicos: una cooperativa, exponente perfecto de economía social, no podía conciliar sus intereses ni podía enfrentarse con los monopolios del capitalismo." [14]. Para evitar eso hace falta un ordenamiento político y social, un Estado, que cambie las "reglas de juego" capitalistas y las sustituya por otras de tipo revolucionario, popular, anticapitalista y pro-cooperativista, ya que "indudablemente el movimiento cooperativo no puede ir adelante sin el apoyo del Gobierno. En todas las partes del mundo las cooperativas han fracasado cuando han tenido en contra al Gobierno." [15].
En concreto, ello implica:
1º) Arrebatar a la oligarquía el control sobre los sectores claves de la economía. Según la Constitución Justicialista de 1949, en su artículo 40, esos sectores clave son la importación y exportación, minerales, caídas de agua, yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, así como los servicios públicos. Corresponde su propiedad, en un principio, al Estado aunque, como ya vimos, a medida que avanza el proceso revolucionario parte de esas actividades pueden pasar a manos de los trabajadores del sector por medio de sus cooperativas obreras o sindicatos. Es posible también, como muestra el caso de SEGBA, la existencia de formas intermedias de cogestión obrero-estatal así como empresas con conducción tripartita: Estado-trabajadores-usuarios.
2ª) Una planificación indicativa que, sin caer en los errores centralistas burocráticos de la planificación de tipo estatista-comunista, impida que con el viejo cuento del "mercado libre" acaben manipulando la economía un puñado de grandes empresas extranjeras o nativas: "La cacareada 'libertad de la economía' no ha pasado nunca de ser una ficción, desde que, a la economía o la dirige el Estado o la hacen, en su lugar, los grandes consorcios capitalistas, con la diferencia de que el primero puede hacerlo en beneficio del pueblo; en cambio, los segundos lo hacen generalmente en su perjuicio." [16].
3º) Formas de apoyo directo del Estado a las cooperativas y empresas sindicales, lo que incluye desde apoyo crediticio preferencial hasta la contratación directa por parte del Estado en aquellas tareas que éste suele descargar en las empresas capitalistas. Aquí conviene recordar una directísima afirmación del General Perón ante miembros del Comité Central y delegados regionales de la CGT que visitaron la Residencia Presidencial de Olivos el 9 de agosto de 1950: "El Gobierno está dispuesto a dar a las cooperativas obreras la oportunidad para que hagan negocios que les permitan ganar mucho dinero; en lugar de dárselos, como se hacía antes, a entidades capitalistas.".
4º) El combate en el terreno ideológico contra las supervivencias de la mentalidad individualista burguesa, fomentando el conocimiento de las formas de economía social y cooperativista, especialmente entre la juventud. El Segundo Plan Quinquenal, por ejemplo, en su apartado IV.G.14 sostiene: "La difusión de los principios del cooperativismo y la constitución de cooperativas escolares y estudiantiles serán auspiciadas por el Estado a fin de contribuir a la formación de la conciencia nacional cooperativista y prestar servicios útiles a los alumnos." [17].
Socialización integral
Cuando anteriormente recordábamos que para el General Perón las cooperativas debían tender a convertirse en las "unidades básicas justicialistas para la organización nacional de la producción, la industria y el comercio", queda claro que la socialización-cooperativización que el Peronismo propugna no se reduce al nivel de cada empresa o unidad económica de producción. Esto es así porque si bien la entrega de todas las empresas a sus propios técnicos y trabajadores autoorganizados en cooperativas, impide tanto la explotación del hombre por el hombre (capitalismo), como la explotación del hombre por el Estado (comunismo) no por ello resuelve todos los problemas de la economía. Para empezar, no asegura la igualdad de oportunidades puesto que existen sectores económicos más productivos que otros y, dentro de cada sector económico, empresas más grandes y más chicas, más modernas y más atrasadas, etc. Tampoco se garantiza una real solidaridad nacional desde el momento en que si esas empresas cooperativizadas se desenvuelven en el marco de una economía de mercado necesariamente se provocará una brutal competencia entre las empresas, considerando cada colectivo obrero o cooperativa un rival en la búsqueda del beneficio a los otros colectivos obreros cooperativos.
Para evitar esos posibles efectos negativos el General Perón impulsa no cooperativas aisladas sino "la unversalización de la organización cooperativa" [18] mediante la Federación de Cooperativas de cada rama de producción. Éstas, estructuradas democráticamente y desde abajo hacia arriba, permiten que cada empresa sea gestionada de un modo directo y sin burocracias externas por sus propios técnicos y trabajadores, pero, a la vez, crea canales solidarios de redistribución de los beneficios generales para apoyar a aquellas cooperativas obreras asociadas que, por diversas razones, tienen que sufrir desventajas objetivas ajenas al trabajo o la gestión de su colectivo laboral: implantación en provincias alejadas del circuito comercial, catástrofes naturales...
Hay que resaltar que, como detalla Perón el 13 de octubre de 1952 en una exposición ante representantes de las cooperativas agropecuarias, esas Federaciones de Cooperativas no engloban sólo a una rama económica sino que participan de un modo directo en todo el proceso productivo y de comercialización. En el caso de esas mismas cooperativas agrarias, Perón propugna concretamente los siguientes campos de acción: "El gobierno aspira a que las cooperativas agropecuarias constituyan las unidades básicas de la economía social agraria y participen, primero: en el proceso colonizador y en la acción estatal tendiente a lograr la redistribución de la tierra en unidades económicas sociales adecuadas. Segundo: que participen en el proceso productivo mediante la utilización racional de los elementos básicos del trabajo agropecuario: maquinaria agrícola, galpones ferroviarios, silos, elevadores de granos, semillas, etc., etc. Tercero: que participen también en el proceso interno de comercialización de las cosechas de sus asociados, para lo cual el Estado auspiciará el acceso de los productores organizados a los centros de consumo, mercados oficiales, proveedurías, etc. Cuarto: que participen en el proceso de la industrialización regional primaria de la producción agropecuaria de sus asociados. Sexto: que participen en la acción estatal tendiente a suprimir toda intermediación comercial innecesaria. Séptimo: que participen en la fijación de precios básicos y precios diferenciales que se fijarán a favor de las cooperativas agropecuarias. Octavo: que participen en la redistribución de los márgenes de utilidad que se obtengan con motivo de la comercialización. Noveno: que participen en la acción social directa a cumplirse en forma integral en beneficio de los productores agropecuarios; y, décimo: el Estado auspicia la organización de un sistema nacional unitario de cooperativas de productores agropecuarios que represente a todos los productores del país y defienda sus intereses económicos y sociales." [19].
Se trata, por lo tanto, de una estructuración integral de la economía que, partiendo de las cooperativas autónomas y descentralizadas, engloba el proceso de producción en su conjunto, racionalizando ese mismo proceso productivo, abaratando costos e impidiendo que cada sector de la cadena productiva y de comercialización compita con los otros. Con decir que para el Líder Justicialista "el gobierno está dispuesto a prestar la ayuda más extraordinaria para que las cooperativas instalen sus propias fabricaciones de herramientas y maquinarias agrarias" [20], está todo dicho. Cada Federación de Cooperativas o "Sistema Nacional Unitario de Cooperativas" además de englobar a todas las cooperativas de ese sector económico, coordina el proceso de producción en su conjunto: desde la producción propiamente dicha a la comercialización, pasando por el transporte y hasta la fabricación de bienes y elementos necesarios.
Empresas sindicales
Las cooperativas federadas no son el único método de socialización impulsado por el Peronismo. En la antes citada entrevista concedida por el General Perón a Carlos María Gutiérrez, el creador del Peronismo menciona un tipo especial de cooperativas: la cooperativa de sindicatos. En éstas, la coordinación de las distintas empresas cooperativizadas se da mediante la organización sindical que, de un modo natural, alcanza a toda la rama de producción. Se alcanza así la vieja tesis del sindicalismo revolucionario, que tanta influencia tuviera en el Movimiento Obrero pre-peronista, y que desde la Carta de Amiens (1916) había proclamado que "el sindicato actualmente nada más que un grupo de resistencia, será en el futuro responsable de la producción y distribución, bases de la organización social" [21]. Como ese modelo de cooperativización sindicalista es más fácil de aplicar en la industria, sector más importante de la economía argentina, es por ello lógico que sea ese mismo modelo el que tienda a predominar en el ideario peronista de tal manera que Perón llega a definir al Estado Peronista futuro como un "Estado Sindicalista" [22].
Las cooperativas o empresas sindicales han sido denominadas a veces también como "Empresas Comunitarias". En "Fundamentos de Doctrina Nacional Justicialista", texto de la "Escuela Superior de Conducción Política del Movimiento Nacional Justicialista" (entre paréntesis, entidad nada sospechosa de "desviaciones izquierdistas") se define de la siguiente forma a la Empresa Comunitaria:
"Considerada en su aspecto funcional, la empresa es una comunidad jerarquizada de productores, diversamente especializados, que aúnan esfuerzos para fabricar determinado artículo o prestar determinado servicio, valiéndose para ello de las herramientas o máquinas que impone la técnica moderna. Considerada, por el contrario, en su aspecto legal, esta misma empresa no pasa, hoy en día, de un mero capital que compra máquinas, materias primas y trabajo. Pura ficción. Pues si con un golpe de varita mágica se suprimieran los dueños del capital, la empresa seguiría funcionando sin la menor perturbación, mientras que pararía y desaparecería si se eliminasen los productores. No basta, por lo tanto, mejorar el nivel de vida del proletariado. No basta dar al productor el lugar que le corresponde en la Comunidad. No resuelve nada cambiar el sistema capitalista sustituyendo la oligarquía burguesa por una oligarquía burocrática. Lo que hace falta es suprimir el salariado, devolviendo a la empresa, aprehendida en su realidad orgánica, la posesión y, de ser posible, la propiedad de su capital, así como la libre disposición del fruto de su trabajo. Cualquier ente social -individuo, grupo o comunidad- tiene el derecho natural de poseer los bienes que le son imprescindibles para subsistir y realizarse plenamente. El municipio, por ejemplo, tiene naturalmente derecho a la propiedad de la vía pública o de la red de alumbrado. El municipio en sí, no la suma de sus habitantes. Cuando alguien viene a instalarse en una ciudad, no tiene que comprar su parte de calle ni de usina; ni la vende cuando se va. La empresa es también un ente social independiente de sus integrantes individuales del momento. Es ella la que tiene que ser dueña de su capital, al que encontrará y usufructuará el productor entrante y dejará para sucesor el productor saliente. Esto vale tanto para la empresa industrial como para la empresa agropecuaria. Los reformistas pequeños burgueses que quieren lotear las unidades orgánicas de nuestro campo fomentan el minifundio y la miseria. La tierra debe ser de quienes la trabajan, como las máquinas de quienes trabajan con ellas. Tal principio no supone, en absoluto, el parcelamiento de la propiedad de los instrumentos de la producción, sino la supresión de la propiedad individualista de bienes que otros -individuos o grupos- necesitan. O sea la supresión del parasitismo en todas sus formas. Eliminado el parasitismo capitalista, las clases desaparecerán 'ipso facto'. No habrá más burgueses ni proletarios, sino productores funcionalmente organizados y jerarquizados en sus empresas. El gremio perderá entonces el carácter clasista que le ha impuesto una lucha necesaria cuya responsabilidad no lleva y volverá a convertirse en una federación de empresas comunitarias, con el patrimonio asistencial que necesita y los poderes legislativo y judicial que definirán sus fueros. En cada gremio, un banco distribuirá el crédito entre las empresas, dentro del marco de la planificación y conducción económica del Estado nacional. La Revolución Justicialista no busca, pues, llegar a una componencia entre capitalismo individualista y capitalismo estatal, ni 'mejorar las relaciones entre capital y trabajo'. Repudia íntegramente cualquier forma de explotación del hombre por el hombre y quiere volver, en todos los campos, al orden social natural. Es éste el sentido de nuestra Tercera Posición." [23].
Las cooperativas sindicales o empresas comunitarias, por lo tanto, coinciden con las cooperativas "tradicionales" en que la propiedad no pertenece a un capitalista individual burgués o al Estado-patrono, pero, a la vez, se diferencian de esas mismas cooperativas en que la propiedad no es divisible ya que pertenece íntegramente a la comunidad laboral de técnicos y trabajadores que las componen. Además, volvemos a recalcarlo, la solución peronista no es sólo a nivel microeconómico (socialización de la empresa) sino también a nivel macroeconómico (socialización global de la economía).
Conducción económica de la Nación
Lo que denominamos socialización "global" o "integral" de la economía es otro de los rasgos que diferencia al Peronismo tanto del capitalismo como del comunismo. Para el General Perón:
"La doctrina económica que sustentamos establece claramente que la conducción económica de un país no debe ser realizada individualmente, que esto conduce a la dictadura económica de los trusts y monopolios capitalistas. Tampoco debe ser realizada por el Estado, que convierte la actividad económica en burocracia, paralizando el juego de sus movimientos naturales. El Justicialismo, siempre en su tercera posición ideológica, sostiene que la conducción económica de la Nación debe ser realizada conjuntamente por el gobierno y por los interesados, que son los productores, comerciantes, industriales, los trabajadores y aun los consumidores; ¡vale decir, por el gobierno y por el pueblo organizado! Mientras esto no se realice plenamente, el gobierno cometerá los errores propios de toda conducción unilateral y arbitraria por más buena voluntad que tenga." [24].
Estas indicaciones, que se refieren a la etapa de transición del Peronismo (cuando aún existe un importante sector económico privado), no suponen, ni mucho menos, que el Líder de la Revolución Nacional argentina oculte el objetivo final anticapitalista de su proyecto. De ahí que, a continuación de lo anterior, aclare: "Nosotros queremos compartir con los intereses privados la conducción económica de la República, pero exigimos que esos intereses se coloquen en la línea peronista que apunta a nuestros dos grandes objetivos económicos: la economía social y la independencia económica, porque ellos son mandato soberano que el pueblo nos ha impuesto y que nosotros tenemos que cumplir de cualquier manera: con la colaboración de las fuerzas económicas si es posible, o enfrentándolas, si ellas no quieren compartir con nosotros el mandato del pueblo soberano. En esta tierra no reconocemos, señores, más que una sola fuerza soberana: la del pueblo. Todas las demás están para servirla. Cualquiera que intente invertir este valor fundamental está, por ese solo hecho, atentando contra el primero, básico y esencial principio del peronismo; atenta, por lo tanto, contra el pueblo y está, por otra parte, fuera de la Constitución Nacional que rige el derrotero de la República (...) Es necesario que nadie se llame a engaño: la economía capitalista no tiene nada que hacer en nuestra tierra. Sus últimos reductos serán para nosotros objeto de implacable destrucción." [25].
La conclusión es que, ya sea con la participación de las organizaciones empresariales (en la etapa de transición) o sin ellas (cuando el Peronismo ha logrado su objetivo económico de entregar los medios de producción a los propios trabajadores autoorganizados), existe una planificación democrática e indicativa en la que participan el gobierno, los trabajadores (mediante los sindicatos, federaciones de cooperativas y de empresas comunitarias), organizaciones de usuarios de servicios y consumidores y todo tipo de organizaciones libres del Pueblo. Se evitan así los errores burocráticos de una planificación burocrática y ultracentralizada como la comunista y, por otro lado, se da un margen de maniobra relativamente grande al mercado [26].
Estado Sindicalista
Pero no sólo el Estado Justicialista va delegando gradualmente funciones económicas en las organizaciones de trabajadores. De hecho el Peronismo apunta a la socialización de la economía y del poder por lo que esas mismas organizaciones de trabajadores, federadas democráticamente desde la empresa hasta subir a nivel nacional, acaban asumiendo la representación y control político gradual del país: "La representación política tiene una función esencial que cumplir en el juego de la verdadera democracia que nosotros propugnamos. Pero también sostengo, como un principio indiscutible que emana de la experiencia política de los últimos tiempos, entre nosotros y en el mundo entero, que tan esenciales como las organizaciones políticas son, en el juego de la verdadera democracia, las organizaciones sindicales. No existe contradicción en nuestra doctrina cuando afirmamos que éste indudablemente es un momento de transición de los Estados políticos a los Estados de estructura sindical (...) La afirmación del derecho a la cooperación con el gobierno del país que nosotros reconocemos, propugnamos y realizamos para las organizaciones sindicales no excluye el derecho de ningún otro argentino; pero en la misma medida en que todos los ciudadanos del país vayan integrando la única clase de argentinos que debe existir en esta tierra: la clase de hombres que trabajan, la representación política dejará de serlo en el antiguo y desprestigiado sentido de la palabra, para adquirir el nuevo sentido peronista de su dignidad." [27].
La socialización de la economía y del poder, por lo tanto, van íntimamente ligadas y, como sagazmente afirmará Perón en un texto de 1968, ambos aspectos no se pueden jamás desligar ya que, en última instancia, los partidos demoliberales (instrumentos burgueses de deformación y control de la voluntad popular) son una consecuencia del capitalismo y, por lo tanto, sin acabar con el capitalismo es imposible sustituirlos por un nuevo y más efectivo tipo de democracia de los trabajadores: "Los que saben 'tomar el rábano por las hojas' y son partidarios de erradicar la política, suelen intentar hacerlo por decreto, sin percatarse que es muy difícil 'matar a nadie por decreto' cuando las causas siguen generando sus efectos, porque poca importancia tiene la existencia legal cuando está sometida la existencia real. Para que desaparezcan las entidades demoliberales, es preciso que antes desaparezca el demoliberalismo. En el mundo de nuestros días, al desaparecer paulatinamente el sistema capitalista, vienen desapareciendo también los partidos demoliberales, que son su consecuencia. Resulta lo más anacrónico cuando se atenta contra esas formaciones políticas mientras por otro lado se trata de afirmar por todos los medios el sistema que los justifica. La intención de dejar a los pueblos sin ninguna representación no es nueva ni es original porque todas las dictaduras lo intentan, pero la Historia demuestra elocuentemente que, cuando ello se produce, las consecuencias suelen ser funestas para las mismas dictaduras que lo promueven." [28].
Al contrario que el demoliberalismo capitalista y burgués, el Peronismo busca "una democracia directa y expeditiva" [29], pero a ella no se llega por dictaduras totalitarias de tipo fascista o marxista, sino por la profundización de esa misma democracia política y su extensión al terreno económico mediante la socialización directa (y no estatista) de los medios de producción. Se trata evidentemente, de un proceso largo, complejo y gradual del que, con sincera modestia, Perón reconoce haber iniciado tan sólo los primeros pasos: "Entre lo político y lo social el mundo se encuentra en un estado de transición. Tenemos la mitad sobre el cuerpo social y la otra mitad sobre el cuerpo político. El mundo se desplaza de lo político a lo social. Nosotros no estamos decididamente ni en un campo ni en el otro; estamos asistiendo al final de la organización política y al comienzo de la organización social (...) Es decir, todo ese proceso se va realizando. Yo no puedo abandonar el partido político para reemplazarlo por el movimiento social. Tampoco puedo reemplazar el movimiento social por el político. Los dos son indispensables. Si esa evolución continúa, nosotros continuaremos ayudando a la evolución. Cuando llegue el momento propicio le haremos un entierro de primera, con seis caballo, al partido político y llegaremos a otra organización. Pero estamos en marcha hacia el Estado Sindicalista, no tengan la menor duda." [30].
La democracia fabril y la autogestión de la economía irá, por lo tanto, sustituyendo gradualmente a los partidos políticos que no tienen porqué ser prohibidos o ilegalizados ya que, dejados de lado por los ciudadanos-productores, lanquidecerán y desaparecerán como cáscaras vacías.
¿Utopía Peronista?
¿Hasta qué punto puede llegar esa socialización de la economía y el poder propugnada por el Peronismo? De hecho el General Perón, y con él la mayoría de teóricos justicialistas, se han negado siempre a elaborar complejísimas elucubraciones al respecto por ser revolucionarios y no utopistas o futurólogos. Además: "La apelación a la utopía es, con frecuencia, un cómodo pretexto cuando se quiere rehuir las tareas concretas y refugiarse en un mundo imaginario; vivir en un futuro hipotético significa deponer las responsabilidades inmediatas. También es frecuente presentar situaciones utópicas para hacer fracasar auténticos procesos revolucionarios. Nuestro modelo político propone el ideal no utópico de realizar dos tareas permanentes: acercar la realidad al ideal y revisar la validez de ese ideal para mantenerlo abierto a la realidad del futuro." [31].
Desde esa perspectiva, desde la visión de un modelo "ideal" al que acercar la realidad y a revisar a la luz de esa misma realidad, puede ser de cierto interés la descripción que del socialismo nacional peronista hace, en la década de los 70, la hoy desaparecida "Tendencia Nacional y Popular del Peronismo":
"El socialismo nacional es el proyecto dentro del cual el pueblo argentino ejercerá un poder decisivo por sí y ante sí en los niveles del Estado, la empresa y la universidad a través del control obrero de los medios de producción, de comunicación y de educación. Es un socialismo de autogestión en el que cada fábrica, cada taller, cada laboratorio, aula o biblioteca se transforma en una célula política con poder de crítica y de control sobre la planificación nacional y la acción política interior y exterior. El socialismo nacional es la democratización absoluta del aparato informativo y la apertura integral de la capacitación técnica a la masa obrera. Es la formación de un partido capaz de emitir todos los impulsos ideológicos necesarios para que en cada momento del proceso el pueblo esté presente, real e intensamente, en la elaboración de las supremas decisiones nacionales. Es la asamblea del pueblo que transforma esos impulsos en leyes populares. Es el Estado técnico-planificador que concierta toda la actividad informativa y prospectiva desde y hacia las estructuras sociales y económicas descentralizadas. Socialismo nacional significa plena vigencia de la opinión comunitaria a través de consejos de producción, servicios y educación. Es la empresa bajo control del colectivo obrero. Es la universidad gobernada por profesores revolucionarios, investigadores y estudiantes. Es la alianza de la universidad y la empresa socializada y sometida al régimen de autogestión. Socialismo nacional es, en suma, participación total, justicia para los trabajadores y dominio del pueblo de todos los resortes de acción política." [32].
Peronismo de los trabajadores
Críticas de detalle al margen, el texto anterior puede considerarse una interesante aproximación a una economía peronista plenamente realizada aunque, volvemos a repetirlo, si en el Peronismo no abundan descripciones detalladas de ese tipo es porqué, a imitación de su fundador, la tarea esencial es imponer en la práctica un modelo político, económico y social que parta de la realidad actual para crear esa realidad nueva. Una realidad que, en un principio, no es aún socialista sino nacional y popular ya que la Argentina preperonista (como reconoce el propio Lenin en su célebre "El Imperialismo, Etapa Superior del Capitalismo" [33]) era una virtual "colonia comercial" británica. Por ello mismo, y sin necesidad de basarse en textos extranjeros, Perón afirma tajantemente que la tarea previa de cualquier revolucionario no era y no es otra que lograr quebrar esas cadenas imperialistas y recuperar la autodeterminación nacional, ya sea frente al imperialismo inglés del pasado o el imperialismo yanqui actual, que recolonizó la Argentina precisamente a partir del derrocamiento militar del Gobierno Popular Peronista en 1955:
"La felicidad de nuestro Pueblo y la felicidad de todos los pueblos de la tierra, exigen que las naciones cuya vida constituyen sean socialmente justas. Y la justicia social exige, a su vez, que el uso y la propiedad de los bienes que forman el patrimonio de la comunidad se distribuyan con equidad. Pero mal puede distribuir equitativamente los bienes de la comunidad un país cuyos intereses son manejados desde el exterior por empresas ajenas a la vida y al espíritu del Pueblo cuya explotación realizan. ¡La felicidad del Pueblo exige, pues, la independencia económica del país como primera e ineludible condición!" [34].
Consecuencia lógica del carácter antiimperialista de la revolución argentina durante su primera etapa es que la contradicción central no es "socialismo o capitalismo" sino "Patria o colonia", "Nación o Imperio", "Liberación o Dependencia". Sectores patrióticos y antiimperialistas, aunque no necesariamente defensores de un socialismo nacional tal cual lo entendía el General Perón, pueden y deben participar activamente en ese verdadero Movimiento Nacional de Liberación que es el Peronismo. Más aún, toda la historia del Peronismo puede reducirse a un esfuerzo doble, genialmente ejemplificado por la conducción de Perón: de un lado ampliar al máximo el Peronismo y su campo político y social de influencia; de otro lado generar los "anticuerpos" organizativos e ideológicos de masas suficientes como para que esa misma amplitud no acabe generando desviacionismos de "derecha" o de "izquierda", o frenando el impulso revolucionario del Movimiento de masas. Y aquí viene como anillo al dedo recordar una de las más conocidas cartas del General Perón a la Juventud Peronista: "No intentamos de ninguna manera sustituir a un hombre por otro; sino un sistema por otro sistema. No buscamos el triunfo de un hombre o de otro, sino el triunfo de una clase mayoritaria, y que conforma el Pueblo Argentino: la clase trabajadora. Y porque buscamos el poder, para esa clase mayoritaria, es que debemos prevenirnos contra el posible 'espíritu revolucionario' de la burguesía. Para la burguesía, la toma del poder significa el fin de su revolución. Para el proletariado -la clase trabajadora de todo el país- la toma del poder es el principio de esta revolución que anhelamos, para el cambio total de las viejas y caducas estructuras demoliberales. (...) Si realmente trabajamos por la Liberación de la Patria, si realmente comprendemos la enorme responsabilidad que ya pesa sobre nuestra juventud debemos insistir en todo lo señalado. Es fundamental que nuestros jóvenes comprendan, que deben tener siempre presente en la lucha y en la preparación de la organización que: es imposible la coexistencia pacífica entre las clases oprimidas y opresoras. Nos hemos planteado la tarea fundamental de triunfar sobre los explotadores, aun si ellos están infiltrados en nuestro propio movimiento político." [35].
La Tercera Posición justicialista no es, por lo tanto, un pálido capitalismo reformista "de rostro humano" ni una mezcla arbitraria de capitalismo y marxismo. Es una solución revolucionaria e integral: "El objetivo central de la 'Tercera Posición' puede resumirse así: 'Socializar sin disolver la personalidad, socializar sin extinguir la independencia de la conciencia individual frente al estado, socializar sin confundir totalmente individuo y sociedad, sociedad y estado." [36].
El General Perón, con su lenguaje siempre más sencillo y comprensible, lo sabrá decir de otra forma: "No todo es pan en esta vida. El trabajador debe no sólamente sembrar el trigo y amanasar el pan sino conquistar una posición, desde la cual puede dirigir la plantación y la fabricación del pan." [37].
Vigencia revolucionaria del Peronismo
En 1983, a poco de recuperar la democracia política en la Argentina, un estudioso del Justicialismo aseguraba con notable perspicacia sobre el Movimiento Peronista:
"En el aspecto ideológico se presentan, en términos sintéticos, tres grandes opciones: a) la de la alvearización bajo el modelo de un partido de inspiración social-cristiana o laborista, ésta última con cierta tradición en el Movimiento; b) la opción por el partido de vanguardia, contenida en las formulaciones del proyecto foquista guerrillero; c) la orientación hacia una democracia autogestionaria de los trabajadores que parte de las experiencias de lucha del justicialismo para articular democracia, lucha obrera y cuestión nacional." [38].
Dichas opciones, a grosso modo, se corresponden con tres interpretaciones históricas diferentes sobre la Doctrina Peronista:
a) Aquellos que se conforman con una reedición más o menos actualizada del periodo 1944-55, es decir: un capitalismo nacional autónomo, independiente con respecto al imperialismo, con fuertes rasgos democrático-populares y altamente distributivo. En esta visión que podríamos denominar "histórica" o "tradicional" del Peronismo deben ubicarso no sólo las fracciones "social-cristiana", "socialdemócrata" o "laborista", sino también ciertas corrientes "nacionalistas", incluso "fascistizantes" (que desdeñan los aspectos democráticos del pensamiento de Perón) o el autodenominado "nacionalismo popular revolucionario peronista", formalmente más "izquierdista" y en la práctica más combativo pero que, respecto a sus objetivos finales, no supera los límites de todo este espacio peronista.
b) El Peronismo fuertemente "heterodoxo" continuador de la pequeña burguesía peronizada en la decada del '60 y que, en diferentes grados y proporciones intenta amalgamar Peronismo y elementos ideológicos extraños a la tradición justicialista: planteamientos filocastristas o maoizantes, foquismo, "nueva izquierda" de los '60, etc. Esta corriente, hoy muy debilitada tras la derrota montonera, intenta ir más allá de la experiencia de 1945-55 pero el Socialismo Nacional que propugna tiene excesiva influencia marxista por lo que choca con la "lógica" del grueso del Peronismo que, generalmente con razón, tiende a visualizarlo como excesivamente en los bordes del Peronismo, con un pié dentro y otro en dirección a las sectas antiperonistas.
c) Quienes entienden que el desarrollo natural del Peronismo es una "democracia autogestionaria de los trabajadores" surgida no por introducción de una ideología o construcción teórica ajena al Peronismo sino como desarrollo de los planteamientos teóricos del propio General Perón y de la experiencia y memoria histórica del conjunto del Movimiento (y no sólo de fracciones internas "de vanguardia"). Esta corriente, por su mismo apego al "sentido común" de las bases y cuadros históricos del Peronismo y, además, ante la bancarrota histórica del marxismo (que salpica a la "izquierda peronista") neo o postmoderna, es la única que, hoy por hoy, puede hegemonizar a la militancia más combativa y consecuente del Movimiento, impidiendo la reedición de enfrentamientos fraticidas internos como los de la década del '70. Más aún, como esta corriente "revolucionaria ortodoxa" o "revolucinaria tercerista" (por reivindicar explícitamente el anticapitalismo del Peronismo, pero también su antimarxismo) surge de la "profundización" del Peronismo "tradicional" y no, como en el caso del montonerismo, de su negación, su posibilidad de desarrollo es enorme; en especial porqué ante una camarilla liberal que usurpa la conducción del Justicialismo pero niega todos sus postulados históricos (nos referimos, obviamente al menemismo) todos los sectores del Peronismo pueden actuar en conjunto durante un largo tiempo más allá de sus matices: "laboristas", "social-cristianos", "socialdemócratas", "nacionalistas", "nacionalistas populares revolucionarios" y "terceristas revolucionarios". El crecimiento de esta última tendencia depende, por lo tanto, más que de la prédica diferenciadora e ideologista, de la conducción práctica de todas y cada una de las luchas y su resultado organizativo.
Notas
1. Este Preámbulo puede consultarse en Julio Godio, El Movimiento Obrero Argentino (1943-1955), Ed. Legasa, Bs. As., 1990, pp. 211 y ss.
2. Juan Domingo Perón, Mensaje del Presidente de la Nación Argentina General Juan Domingo Perón al inaugurar el 86º Periodo Ordinario de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, 1952, pp. 125-126.
3. Julio Meinville, Política Argentina 1949-1956, p. 284 (artículo del 29 de junio de 1951).
4. Juan Domingo Perón, op. cit., p. 47.
5. El término "autogestión" fue introducido en Francia a fines de los años 60 para designar un modo de socialismo no estatista, caracterizado por la "gestión directa" de la empresa por sus propios trabajadores, y no por los capitalistas privados o el Estado. Junto a esa concepción "restringida" de la autogestión (económica y reducida a nivel de empresa) existe otra concepción más amplia, y también más próxima al pensamiento del General Perón, que entiende la autogestión no sólo en el plano económico sino también, y a la vez, en el terreno político; socialización de la economía y el poder. La autogestión "integral" tiene entre sus antecedentes a diversas expresiones no marxistas del Movimiento Obrero europeo (asociacionismo de Proudhon, socialismo utópico de Fourier, anarcosindicalismo y sindicalismo revolucionario español, italiano y francés, guildismo inglés), corrientes marxistas diferenciadas del stalinismo y el trotskismo (consejistas, "titismo" yugoeslavo), pensadores revolucionarios cristianos (Mounier, Lebret) y ciertos Movimientos de Liberación del Tercer Mundo (el Frente de Liberación Nacional argelino durante la etapa de Ben Bella, la "Ujamaa" de Nyerere en Tanzania, la Revolución Nacional de Velasco Alvarado en Perú, determinados planteamientos del General Torrijos en Panamá, etc.). Se tratan, en todo caso, de diversos modelos nacionales que, hasta el momento, no se han consolidado por razones de orden político: relación de fuerzas nacional e internacional, etc.
6. Cristián Buchrucker, Nacionalismo y Peronismo, Ed. Sudamericana, Bs. As., 1987, p. 318.
7. J.D. Perón, La Fuerza es el Derecho de las Bestias, 1958, p. 14.
8. Eva Perón, "Historia del Peronismo" (curso de 1951), en Clases y Escritos Completos (1946-1955), Ed. Megafón, Bs. As., 1987, Tomo III, p. 98.
9. Juan Domingo Perón, Breve Historia de la Problemática Argentina, Ed. Claridad, Bs. As., 1989, p. 151 (transcripción de una serie de entrevistas concedidas a Eugenio P. Rom en 1967).
10. Juan Domingo Perón en Carlos María Gutiérrez, Reportaje a Perón. Diálogo sobre la Argentina Ocupada, Schapire Editor, Bs. As., 1974, p. 79.
11. Juan Domingo Perón, Mensaje del Presidente..., op. cit., p. 83.
12. Ibid., pp. 82-83.
13. Ibid., p. 57.
14. Ibid., p. 38.
15. Juan Domingo Perón, discurso ante horticultores bonaerenses en la Casa de Gobierno, 21 de septiembre de 1951.
16. Juan Domingo Perón, Los Vendepatria. Las pruebas de una Traición, Ed. Freeland, Bs. As., 1974, p. 166 (la primera edición es de 1957)
17. 2º Plan Quinquenal, Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, Bs. As., 1953, p. 89.
18. Juan Domingo Perón, discurso ante representantes de cooperativas agrarias, 13 de octubre de 1952. Reproducido íntegramente en Mundo Peronista, Bs. As., n. 33, 15 de noviembre de 1952, p. 44.
19. Ibid., pp. 44-45.
20. Ibid., p. 45.
21. La progresiva "nacionalización" del Movimiento Obrero Argentino en el periodo de la "Década Infame" y su posterior influencia en el naciente Peronismo puede comprobarse en Hiroshi Matsushita, Movimiento Obrero Argentino (1930- 1945), Hyspamérica, Bs. As., 1983.
22. Sobre la influencia de la doctrina sindicalista revolucionaria en el Peronismo y el concepto de "Estado Sindicalista" en el General Perón ver la segunda parte del presente estudio: Sindicalismo Revolucionario Peronista, Ed. Guerra Gaucha, Bs. As.
23. Escuela Superior de Conducción Política del Movimiento Nacional Justicialista, Fundamentos de Doctrina Nacional Justicialista, Eds. Realidad Política, Bs. As., 1985, pp. 103-104.
24. Juan Domingo Perón, Mensaje del Presidente..., op. cit., p. 67.
25. Ibid. pp. 68-69.
26. No se trata, obviamente, del delirio liberal-menemista de la "economía popular de mercado", versión disfrazada de la "economía social (?) de mercado" del infame Alsogaray. Sin embargo, en experiencias socialistas autogestionarias bastante desarrolladas, como es el caso de la Yugoslavia de Tito, la práctica demostró la imposibilidad de una planificación total y la necesidad, dentro de una planificación indicativa, de ciertas formas de mercado libre que, al no existir grandes monopolios ni diferencias económicas destacadas, es realmente eso: libre. Ver D. Bilandzic y S. Tokovic, Autogestión (1950-1976), El Cid Editor, Bs. As., 1976.
27. Juan Domingo Perón, Mensaje al Presidente..., op. cit.. pp. 122-123.
28. Juan Domingo Perón, La Hora de los Pueblos, Ed. Distribuidora Baires, Bs. As., 1974, p. 130 (la primera edición es de 1968).
29. "Por otra parte, la democracia de nuestro tiempo no puede ser estática, desarrollada en grupos cerrados de dominadores por herencia o por fortuna, sino dinámica y en expansión para dar cabida y sentido a las crecientes multitudes que van igualando sus condiciones y posibilidades a las de los grupos privilegiados. Esas masas ascendentes reclaman una democracia directa y expeditiva que las viejas ya no pueden ofrecerles", Ibid., p. 14.
30. Juan Domingo Perón, discurso ante escritores asociados a la Confederación Argentina de Intelectuales, reproducido por Hechos e Ideas, Bs. As., n. 77, agosto de 1950.
31. Juan Domingo Perón, Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, Ediciones Realidad Política, Bs. Aires, 1986, p. 88 (esta obra es el discurso pronunciado el 1º de mayo de 1974 por el General Perón ante la Asamblea Legislativa al inaugurar el 99º periodo de sesiones ordinarias del Congreso, así como el proyecto que presentó al mismo).
32. Este manifiesto, de junio de 1972, se encuentra reproducido como anexo en varios autores, Peronismo: de la Reforma a la Revolución, A. Peña Lillo Editor, Bs. As., 1972, pp. 187 y ss.
33. "No sólo existen los dos grupos fundamentales de países -los que poseen colonias y las colonias-, sino también, es característico de la época, las formas variadas de países dependientes que desde un punto de vista formal, son políticamente independientes, pero que en realidad se hallan envueltos en las redes de la dependencia financiera y diplomática. A una de estas formas de dependencia, la semicolonia, ya nos hemos referido. Un ejemplo de otra forma lo proporciona la Argentina.", V. I. Lenin, El Imperialismo, Etapa Superior del Capitalismo, Ed. Anteo, Bs. As., 1975, pp. 105-106. La edición original es de 1916.
34. Juan Domingo Perón, Mensaje del Presidente..., op. cit., p. 31.
35. Carta de Juan Domingo Perón a la Juventud Peronista, octubre de 1965. Reproducida en Roberto Baschetti, Documentos de la Resistencia Peronista (1955-1970), Puntosur Eds., Bs. As., 1988, pp. 222-223.
36. Salvador Ferla, La Tercera Posición Ideológica y Apreciaciones Sobre el Retorno de Perón, Ed. Meridiano, Bs. As., 1974, p. 23.
37. Juan Domingo Perón, discurso ante representantes obreros, 24 de febrero de 1949. Citado en Habla Perón (selección de textos), Ed. Realidad Política, Bs. As., 1984, p. 106.
38. Jorge Luis Bernetti, El Peronismo de la Victoria, Ed. Legasa, Bs. As., 1983, pp. 210-211. Por "alverización" se entiende un proceso de "domesticación" e integración al Sistema, similar al que Alvear realizará con la Unión Cívica Radical a la muerte de Hipólito Yrigoyen.





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg